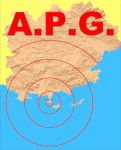A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – U – V – W – X – Y – Z
Abiotique (adj.)
1. Non vivant. [1]
Les facteurs abiotiques intervenant en écologie sont physiques et chimiques.
2. Qui rend la vie impossible. [2]
Syn. Azoïque
Ex. Environnement abiotique
Abondance
L’abondance d’une espèce est une évaluation du nombre de ses individus distribués dans un espace défini.
On peut aussi définir l’abondance d’un groupe d’espèces (les passereaux, les conifères, les carnivores…) comme la somme des abondances des espèces qui le composent. On parle alors d’abondance cumulée.
L’abondance peut s’évaluer au niveau d’une population locale, définie par un périmètre géographique, comme un étang, une forêt, un océan, un pays…, ou bien correspondre à l’effectif de l’espèce dans sa totalité si l’espace considéré est la biosphère.
L’abondance peut être qualifiée d’absolue si elle ne concerne qu’une espèce étudiée, et on parle alors d’effectif.
Ex. En 2019 le continent africain (espace défini) comptait environ 415 000 éléphants.
Ou elle peut être relative si elle est rapportée à celle d’un autre groupe d’espèces, et on l’exprime alors en pourcentage.
Ex. Le sapin pectiné (Abies alba) constitue 24% de la forêt vosgienne.
En France particulièrement, la notion d’abondance relative a souvent été confondue avec celle de dominance, ce qui nous parait une erreur.
L’abondance peut traduire un comptage direct des individus recensés. Les ornithologues par exemple le font très souvent, parfois quotidiennement, au sujet des populations d’oiseaux aquatiques qui occupent les sites qu’ils surveillent. Mais les situations où le comptage direct, et si possible exhaustif, des individus est possible sont en fait extrêmement rares et toutes sortes de méthodes alternatives plus ou moins pertinentes ont été utilisées : collecte des crottins des cervidés, ou des pelotes de réjection des rapaces, chant des oiseaux, traces au sol…
Quand le comptage direct est inenvisageable, du fait par exemple d’effectifs indénombrables de l’espèce étudiée (protistes, insectes…), ou de la taille de l’unité géographique considérée (océans…), l’abondance peut aussi être estimée par le biais de différentes techniques d’échantillonnage selon un maillage spatial adapté à l’espèce, ou au groupe d’espèces étudié : on procède à un, ou plus généralement plusieurs recensements/comptages des individus limités à une unité de surface, ou de volume : mètre-carré ou mètre-cube (plancton), hectare (végétation), kilomètre-carré (grande faune), etc., ce qui conduit à quantifier la densité spatiale locale de l’espèce, qu’on peut ensuite extrapoler à l’effectif occupant l’espace étudié. Étant donné par ailleurs la dépendance de nombreux facteurs écologiques à la densité des populations, il est souvent plus instructif d’établir le nombre d’individus par unité de surface d’une région particulière plutôt que l’effectif total de la population qui l’occupe.
Si un autre facteur, comme par exemple la grande mobilité des individus, empêche de les compter efficacement dans les limites d’une maille d’échantillonnage, on peut aussi utiliser des techniques à base de marquage, comme celle dite de « capture/marquage/recapture » très utilisée par exemple sur les poissons, qui permettent d’estimer la taille d’une population.
Enfin on peut aussi vouloir évaluer l’abondance relative des individus d’une classe d’âge, ou des sexes (sexe-ratio) au sein d’une population.
Aire protégée
Espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées.
« Les aires protégées contribuent directement à la lutte contre l’érosion de la biodiversité et le changement climatique. Leur développement est fondamental pour préserver la nature et inventer de nouvelles manières de vivre avec elle. En France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer, la surface totale des aires protégées représente 33 % du territoire national et de nos espaces maritimes sous juridiction et souveraineté. »
[Ministère en charge de l’environnement, 30 mai 2022]
>> Article Wikipédia
>> Article « Les aires protégées en France » (Ministère en charge de l’environnement)
Azoïque (adj.)
Inhabité par les êtres vivants. [1]
Si on s’en tient strictement à cette définition, de tels milieux totalement dépourvus de vie sont infiniment rares sur Terre, si même ils existent en dehors des roches compactes de profondeur et des fournaises de l’intérieur du globe. Le terme d’ « azoïque » est en fait généralement utilisé pour qualifier un milieu dépourvu d’organismes évolués, par opposition aux microorganismes.
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – U – V – W – X – Y – Z
____________________
Références :