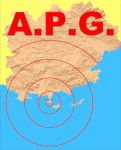Les fonds marins meubles, à partir de quelques mètres de profondeur, ainsi que la roche fissurée, favorable à un ancrage dès la surface, sont colonisés par une prairie verte et drue. Toute aquatique qu’elle soit, l’herbe qui y exerce son hégémonie n’est pas une algue, organisme primitif s’il en est, mais une authentique plante supérieure très évoluée, avec ses vraies racines, tiges, feuilles, fleurs et graines. Il s’agit de la Posidonie, ou herbe de Poséidon, dieu grec de la mer.
La tradition locale nomme « herbier » cette prairie et « mattes » les récifs-barrières qu’elle édifie patiemment au cours d’une croissance verticale séculaire. Les paysages sous-marins qu’elle engendre sont souvent monotones, mais cette uniformité est un gage de bonne santé et cache sa richesse, une vie animale grouillante et colorée : poissons de soupe et de bouillabaisse, poulpes et seiches, oursins aux nuances variées (récolte interdite l’été !), la Grande nacre (Pinna nobilis), très rigoureusement protégée qui est, comme l’huître et la moule, un bivalve, mais de grande taille et qui vit « plantée » dans le sable, etc. À tous ses hôtes l’herbier offre un gîte hospitalier, un couvert généreux et une nurserie abritée.

L’herbier de posidonies illustre brillamment une loi de la nature, qui apparaît universelle, celle dite « des séries » ou « successions végétales » : sur terre autant que sous la mer, la végétation démarre sur les substratums nus, qu’ils soient meubles ou rocheux, par l’installation d’espèces pionnières primitives et modestes, essentiellement cryptogamiques (c’est-à-dire des plantes sans fleurs), des lichens et des mousses dans un cas, des algues dans l’autre. Quand les conditions de vie s’améliorent, notamment du fait de la formation d’un premier sol, des végétaux de plus en plus évolués arrivent à s’installer et à se développer, qui accueillent ensuite une faune de plus en plus diversifiée.
L’exubérance étonnante que peuvent atteindre ces peuplements d’herbiers ne constitue pas, hélas, un acquis définitif. Des causes diverses, certaines naturelles et difficiles voire impossibles à maîtriser, comme l’intrusion d’espèces invasives, ou d’autres, engendrées par l’Homme, dont la pollution est la plus insidieuse en mer, sont susceptibles de menacer gravement ces formations, en les appauvrissant et en en réduisant l’étendue. Ces agressions de la biocénose se traduisent alors par sa régression vers des états immatures et engendrent le retour d’espèces pionnières primitives, notamment la prolifération d’algues vertes indigènes, ou parfois exotiques comme la Caulerpa taxifolia, qui, qualifiée d’« algue tueuse », a un moment défrayé la chronique et effrayé le monde de l’écologie par sa toxicité, associée à une croissance et un potentiel invasif exceptionnels, pour finalement… entrer en régression, voire en disparition spontanée en Méditerranée ! En 2015, elle avait déjà disparu de 80 % des sites qu’elle avait colonisés, sans qu’on ait encore la moindre explication étayée du phénomène, ce qui avouons-le ne nous empêchera pas de nous réjouir de cette excellente nouvelle, elles sont si rares en matière d’environnement…
Michel AUTEM & Pierre VIGNES